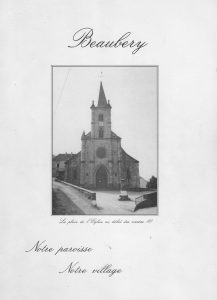
La paroisse, la commune, les écoles (dans cet ordre chronologique) font partie des piliers qui ont structuré peu à peu les villages de France.
Sous l’Ancien Régime, la communauté de base était la paroisse régie, comme encore de nos jours, par un curé placé sous l’autorité de l’évêque. Le plus ancien curé connu à Beaubery est Jean Demontet en 1482. Il serait fastidieux d’égrener la liste de tous les ministres du culte depuis cette date ; citons-en trois qui ont marqué leur époque. Pendant la période révolutionnaire (de 1789 à 1801, date du Concordat entre la France et le Saint Siège), c’est le chanoine Rotheval qui était en poste à Beaubery : un colosse que les gendarmes chargés de le surveiller n’impressionnaient pas…
Puis, de 1841 à 1876, ce fut l’abbé Chaintreuil, un bâtisseur. C’est sur son initiative qu’a été érigée la nouvelle église, en 1846-47, reconstruit le presbytère en 1860, installées la grosse cloche en 1869 et l’horloge en 1875. C’est également lui qui sollicita le Marquis de Sommyèvre pour la construction des deux écoles dans les années 1850.
Enfin, il faut citer son successeur, l’abbé Paul Muguet de 1876 à 1890, un historien, membre de la Société Eduenne des Lettres et des Arts, qui a, entre autres, rédigé une monographie de la paroisse de Beaubery, consultable aux Archives Départementales.
Les curés du XXe siècle sont encore présents dans la mémoire des beauberichons : les abbés Lacôte (1890-1921), Tournier (1921-1945) et Marmorat (1946-1967) qui fut le dernier à résider à la cure du village.
Ensuite, le presbytère a été loué en logements par la commune, puis réhabilité par l’OPAC en 1999 pour y créer 5 appartements et une salle de réunion.
Les communes ont été crées à la Révolution (loi du 14 décembre 1789) en même temps que les départements, arrondissements et cantons. Elles sont dirigées par un conseil municipal élu au suffrage universel et présidé par le maire. Les maires, d’abord dénommés « agents municipaux », sont successivement élus au suffrage direct par les citoyens « actifs » de la commune ou bien nommés par les préfets. Ce n’est que depuis 1871 que nous connaissons le système actuel : élection des conseillers municipaux (au suffrage universel direct, exclusivement masculin à l’époque) qui élisent ensuite le maire et les adjoints.
Une maison commune, la mairie, est construite ou désignée dans chaque village. A Beaubery, durant le XIXe siècle, le lieu de réunion du conseil municipal a changé plusieurs fois : dans les salles de classe, l’auberge… En 1920, la commune loue à M. Large un local pour y installer provisoirement la mairie ; les gens appelaient ce local « la ptchète chopine », allez savoir pourquoi ?
En 1923 la municipalité achète et aménage le corps de bâtiments où elle se trouve encore de nos jours.
Nous connaissons la liste exhaustive des maires depuis 1792 :
| 1792 – 1793 | Pierre GOIN | 1925 – 1931 | Antoine LEVITE |
| 1793 – 1796 | Jean CHEMARIN | 1931 – 1940 | François ALEVÊQUE |
| 1796 – 1798 | Jean-Baptiste DARGINTET | 1940 – 1945 | Jean MYARD |
| 1798 – 1806 | Pierre GOIN | 1945 – 1951 | Jean-Claude LAPALUS |
| 1806 – 1826 | Jean-Claude BONIN | 1951 – 1958 | Jean ROLLET |
| 1826 – 1863 | Jean-Marie LAROCHETTE | 1958 – 1967 | Philippe GILLOUX |
| 1864 – 1913 | Ludovic CHEUZEVILLE | 1967 – 1992 | Albert AUFRANC |
| 1913 – 1917 | Jean-Marie BURILLIER | 1992 – 1995 | Jacques VINCENT |
| 1917 – 1918 | Les adjoints ALEVÊQUE et THERVILLE ont fait fonction. | 1995 – 2008 2008 – 2010 |
André AUCLAIR Gérard AUPOIL |
| 1919 – 1925 | François ALEVÊQUE | 2010 …. | Gérard DUCHET |
Les écoles.
Avant 1789, l’instruction était souvent l’affaire des curés, mais de façon épisodique. Le fameux chanoine Rotheval, chassé du presbytère à la Révolution, avait créé une classe dans sa maison du bourg. On trouve trace, dans les recensements de la première moitié du XIX° siècle, d’instituteurs laïcs à Beaubery, mais il n’y avait pas de maison dédiée à l’école.
C’est en 1853 qu’est construite l’école de filles, à l’entrée Nord du bourg, puis en 1857 celle des garçons, à la place de l’actuelle salle des fêtes. Ces bâtiments furent financés par le Marquis de Sommyèvre (Corcheval) à la demande du curé Chaintreuil. Ils seront donnés à la commune en 1860. L’enseignement était dispensé, selon les vœux du donateur, par des sœurs de Saint François d’Assise pour les filles, et par des Petits Frères Maristes pour les garçons. A partir des années 1860, les recensements attestent régulièrement de la présence de trois religieux enseignants chez les garçons et trois religieuses à l’école des filles.
Dans les années 1880, la troisième république mène la vie dure aux congrégations enseignantes. A Beaubery, comme dans tout le monde rural, la loi Ferry de 1886 imposant la laïcisation du personnel enseignant est appliquée sans empressement… Finalement, par arrêté préfectoral du 11 décembre 1891, les frères sont chassés de l’école de garçons et les premiers instituteurs laïcs sont M. et Mme Charlot. Cette laïcisation va entraîner l’annulation de la donation du bâtiment scolaire à la commune, qui devra payer un loyer à M. de Sommyèvre. Ce dernier refera définitivement don de l’édifice en juillet 1903.
Les sœurs, quant à elles, ne seront expulsées qu’en 1902 ; les filles sont alors « entassées » avec les garçons à l’école publique du haut (68 garçons et 71 filles pour 4 classes confinées dans deux salles) ! Très vite les sœurs de St-François sont autorisées à fonder un établissement d’enseignement privé en vertu de la loi 1901 sur la liberté d’association; c’est la naissance de l’école libre en 1906, qui s’installera tout naturellement dans l’école du bas redonnée par les héritiers de Sommyèvre à cette congrégation. La majorité des filles de la commune seront, par la suite, scolarisées à l’école libre, qui perdurera jusqu’en 1977, quand l’institutrice, Mademoiselle Laroche, est partie en retraite.
A partir de cette date, il n’existera plus qu’une seule école dans la commune, l’école publique. Entre temps, le bâtiment a donné des signes de faiblesse (les planchers de l’étage et du grenier menaçaient de s’affaisser). En septembre 1959, la commune a décidé de construire une école neuve dans une parcelle voisine. Elle sera mise en service à la rentrée 1962.
La diminution constante des effectifs a conduit à la création, en 1993, d’un regroupement pédagogique intercommunal avec Vérosvres pour aboutir à la situation actuelle : deux classes maternelles et CP à Beaubery (32 enfants) et deux classes primaires à Vérosvres (37 enfants) avec un service de transport et deux restaurants scolaires.
Autre service public : la poste, le télégraphe et le téléphone.
A la fin du XIXe siècle, le courrier arrivait en gare de Beaubery, était emmené à la poste de St-Bonnet, puis redistribué sur Beaubery en fin de journée…
Par délibération du 17 novembre 1907, le conseil municipal sollicite l’établissement d’un bureau de poste à Beaubery. Un arrêté ministériel de juin 1908 autorise cette création, et le bureau ouvrira le 1er février 1909 dans la maison Lauprêtre (actuelle demeure de J-J Jacquet au bourg). Le premier receveur fut Pierre Dumont jusqu’en 1933, puis Jean-Marie Devif jusqu’en 1947 et Gabriel Jardy (1947-1967).
Le bureau sera transféré dans le bâtiment de la mairie en 1924 et y restera jusqu’en 2015, date à laquelle il sera transformé en « relais poste commerçant » et délocalisé à la boulangerie.
Le télégraphe est installé à la poste durant l’été 1909, à défaut d’y brancher le téléphone jugé trop onéreux (l’établissement d’une ligne téléphonique Beaubery – St-Bonnet aurait coûté 5390 francs) !
Il faudra attendre 1923 pour qu’une convention soit signée avec la direction des postes pour l’installation du téléphone sur la commune. Bien sûr, les premières maisons équipées d’appareil téléphonique étaient rares. Jusque dans les années 1960, des « cabines publiques » étaient disponibles chez des particuliers dans les hameaux de la Gare et Givry.
Quant aux téléphones portables et à la connexion au réseau internet, leur apparition date des années 1990, mais il faut attendre l’année 2016 pour voir l’installation de la fibre optique permettant de bénéficier du « haut débit »…
L’électricité.
Dès 1925 la commune adhère au Syndicat d’Electrification des Campagnes du Charolais et vote en 1926 un premier emprunt de 228 000 francs pour l’électrification du village. Mais l’électricité n’arrive à Beaubery qu’en 1929. Les premiers foyers desservis sont situés le long de la route départementale (de la gare au bourg) ; l’éclairage public date de la même année.
L’alimentation des hameaux en « lumière » et « force motrice » s’effectuera tout au long des années 1930. La dernière tranche d’électrification des « écarts » s’achèvera en 1939. Le tout aura coûté plus d’un million de francs (un tiers de subventions et deux tiers d’emprunt).
L’usage de la fée électricité se faisait avec parcimonie : une ou deux lampes par maison, une prise de courant monophasé (pour un fer à repasser ou un poste radio), et le triphasé (la fameuse force motrice) pour ceux qui disposaient de moteurs électriques.
Le goudronnage des routes.
C’est aussi un des aspect de la modernité du XXe siècle : il fallait faciliter les nouveaux modes de transport que sont l’automobile et le camion.
En mars 1930 le conseil municipal décide le goudronnagede la route départementale 79 sur une longueur de 500 mètres dans la traversée du bourg. Le reste de la route sera empierrée et goudronnée, par le département, juste avant la seconde guerre mondiale.
Les premières voies communales à être goudronnées sont la route de Vérosvres et celle de Charolles ; la délibération est prise en avril 1954 et les travaux réalisés en 1955 (empierrement et goudronnage sur 5500 mètres depuis les Quatre Chemins jusqu’à Montchalon pour un coût de deux millions et demi de francs, subventionné à 40% par le département).
Petit à petit l’ensemble du réseau des chemins ruraux sera refait. Il y a aujourd’hui un peu plus de 30 km de voies communales goudronnées à Beaubery. Depuis quelques années, cette compétence de voirie est partiellement transférée à la Communauté de Communes.
Un événement notoire a eu lieu en ce milieu du XXe siècle : la création de la RCEA (Route Centre Europe Atlantique) sur le tracé de l’ancienne ligne de chemin de fer. Le tronçon Clermain-La Fourche qui traverse notre commune a été inauguré en juin 1970.
L’eau.
Jusque dans les années 1970, l’approvisionnement en eau potable des maisons et des fermes restait un problème individuel… On voyait beaucoup de puits dans les cours ou sur les places des hameaux. Les plus fortunés ou les plus ingénieux avaient l’eau courante, provenant souvent d’un captage situé en amont, ou plus tard d’un réservoir placé au grenier et alimenté par une pompe électrique aspirant l’eau du puits. Cette eau restait un bien précieux qu’il convenait d’épargner !
En 1966, la commune adhère au Syndicat Intercommunal des Eaux de l’Arconce. En septembre 1970, une délibération est prise pour demander au préfet d’inscrire la commune au prochain programme départemental d’alimentation en eau potable. Les travaux d’infrastructure (station de pompage de Vaivres, château d’eau du Chatelard) débutent en 1972 et les premiers branchements au réseau datent de 1974 pour s’achever en 1979. On compte alors 200 abonnés.
Vingt ans plus tard, en 1998, la première tranche du réseau d’assainissement collectif est entamée (création des lagunes), puis en 1999 la réalisation du réseau de collecte qui concerne environ 50 foyers du centre bourg.
sources : archives communales : délibérations du conseil municipal de 1839 à nos jours.
archives départementales : recensements de la population de 1836 à 1936, écoles communales laïques et congréganistes, monographie de l’abbé Muguet.
témoignages des anciens du village.